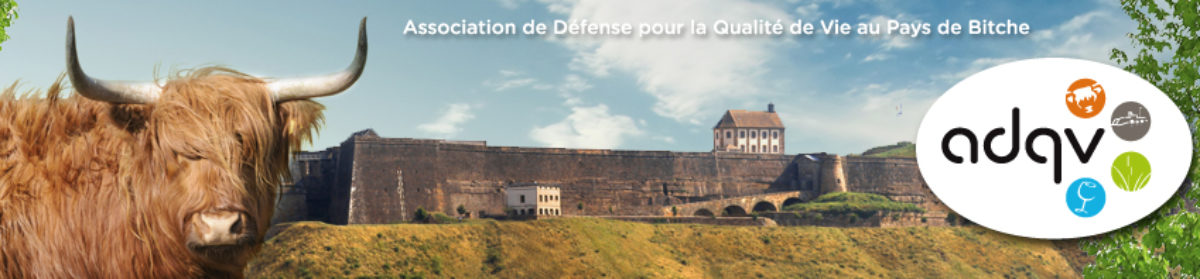Le gouvernement revoit à la baisse son soutien à la filière du biogaz. Sur le terrain, l’opposition des associations aux méthaniseurs grandit.
Par Stéphane Mandard, Nabil Wakim et Simon Auffret Publié le 30 janvier 2019 à 11h34

Le « gaz vert » a-t-il un avenir en France ?
Alors que les groupes gaziers, les exploitants agricoles et certains fonds d’investissement misent depuis plusieurs mois sur un fort développement de la méthanisation, les nuages s’accumulent au-dessus de leurs têtes. En présentant, le 25 janvier, la feuille de route énergétique de la France, le gouvernement a douché leurs espoirs, en revoyant à la baisse les objectifs de développement du « gaz vert », issu de déchets agricoles ou ménagers. Selon le document de synthèse de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), le biogaz devrait fournir 7 % de la consommation de gaz en France en 2030. La loi de transition écologique de 2015 fixait 10 % à cette date, et la filière gazière espérait même atteindre 30 %.
Pourquoi renoncer à de tels objectifs ? Principalement pour des raisons de coût : le gouvernement ne veut pas d’un soutien public trop important au développement de ce secteur. L’exécutif fixe donc des objectifs en forte croissance – le biogaz représente moins de 1 % de la consommation de gaz en France en 2018 –, mais contrarie les espoirs des industriels en matière de subventions.
« Question de l’acceptabilité »
Deux appels d’offres seront certes lancés chaque année, mais le prix d’achat proposé par l’Etat sera très inférieur à celui proposé aujourd’hui. Les entreprises du secteur expliquent depuis plusieurs mois que le développement du gaz renouvelable en France a encore besoin d’un soutien public pour franchir un cap, et in fine faire baisser les prix. Les associations professionnelles du gaz dénoncent des mesures qui risquent de « condamner l’avenir de cette filière sans tenir compte de ses avantages ». Tandis que les syndicats agricoles FNSEA et Jeunes Agriculteurs déplorent une trajectoire « strictement impossible à tenir », qui ne laisse « aucune chance aux projets agricoles et territoriaux de se développer durablement».
« Il faudrait aller encore plus vite pour atteindre les objectifs de la programmation pluriannuelle pour l’énergie, estime de son côté Marc Cheverry, le directeur en charge de l’économie circulaire et de la gestion des déchets à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe). Nous avons la possibilité de le faire. Le plus gros frein n’est pas technique, mais la question de l’acceptabilité. »
Ce recul des pouvoirs publics intervient en effet au moment où le développement de la méthanisation rencontre des oppositions sur le terrain. Une mobilisation plus faible que contre l’éolien, mais qui prend de l’importance.
Développement mal maîtrisé
Lundi 28 janvier, le cabinet du
ministre de la transition écologique et solidaire a reçu pour la première fois
des collectifs d’opposants. Créé à l’été 2018, le Collectif national vigilance
méthanisation est constitué d’une trentaine d’associations locales. Fondé en
décembre, le Collectif scientifique national sur la méthanisation rassemble,
lui, une vingtaine de chercheurs de toutes disciplines.
Les deux collectifs s’inquiètent d’un développement mal maîtrisé de la
méthanisation et de risques de pollutions à tous les stades du processus :
contrôle de la qualité des déchets, possibles rejets de gaz à effet de serre,
conditions de stockage et d’épandage du digestat, la matière résiduelle de la
méthanisation.
Cette rencontre témoigne de la montée en puissance progressive de ces
oppositions, alors que les projets se multiplient : plus de 600 projets de
méthaniseurs, de toute taille, sont en cours de développement, selon le bilan
annuel de la société de transport de gaz GRT Gaz, avec un objectif de 1 000
installations agricoles en 2020. Dans le Grand Est, les craintes se concentrent
sur le développement d’un modèle proche de celui de l’Allemagne, critiqué pour
détourner une agriculture consacrée à l’alimentation vers la production
d’énergie.
L’association Eaux et Rivières de Bretagne a déposé un recours devant le
Conseil d’Etat pour contester l’assouplissement de la réglementation décidée
par le gouvernement. « Le principe de la méthanisation est vertueux, note
Estelle Le Guern, chargée de mission agriculture de l’association. Mais tout
dépend de sa mise en œuvre, et celle choisie ne nous convient pas, notamment
par le manque de contrôle des installations. »
Au-delà de ces difficultés de mise en œuvre, c’est le modèle économique de la méthanisation qui risque d’avoir raison des ambitions de la filière. Sans soutien financier de l’Etat, le « gaz renouvelable » est très coûteux à produire et commercialisé à des tarifs largement supérieurs à ceux du gaz naturel.
Quelles conclusions en tirer pour le bio gaz produit par Methavalor l’usine de méthanisation du Sydeme?
Le prix proposé par l’Etat sera très inférieur à celui proposé aujourd’hui.
Sans soutien financier de l’Etat, le « gaz renouvelable » est très coûteux à produire et commercialisé à des tarifs largement supérieurs à ceux du gaz naturel.